« La montre au lait perdu »

Hier, malgré tout, je me suis acheté une montre. Une montre dorée, modeste mais brillante, venue d’un ailleurs lointain ou simplement d’ un rêve empaqueté dans du plastique. Elle scintillait doucement, comme pour me dire que le temps pouvait encore se porter avec élégance, même quand on n’en maîtrise plus les battements. Je l’ai choisie comme on panse une blessure : vite, avec un reste de dignité maquillée.
Et aujourd’hui, j’ai pleuré. Longtemps. En silence. Pas un sanglot noble. Non. Une vraie pluie intérieure. Incontrôlable, nue. Une pluie qui ne parle ni anglais ni français ni Arabe, mais une langue brute, venue de la cage thoracique, des tripes, de cet endroit où naissent les poèmes qu’on n’a pas invités.
Assise, les poignets posés sur mes genoux, la montre cliquetait doucement, indifférente à mes larmes. Elle ne me consolait pas, elle ne m’interrogeait pas. Elle marquait l’heure, bêtement, comme si la douleur avait une durée limitée. Comme si l’instant ne méritait pas qu’on l’arrête.
Puis, j’ai eu faim. Cette faim étrange qui ne vient pas du ventre mais du besoin de se raccrocher à quelque chose de doux, de chaud, de simple. Alors j’ai battu un œuf. J’y ai mis un peu de lait, une pincée de vanille. J’ai trempé du pain dur dans ce mélange, comme on plonge ses souvenirs dans un baume tiède. Et dans une vieille poêle cabossée, j’ai fait dorer ma peine.
Je l’ai mangé lentement. Pain perdu, moi aussi. Mais chaud, sucré, vivant. Avec un verre de lait parce que parfois, il ne reste que ça pour ne pas sombrer : un goût d’enfance, une douceur blanche, une gorgée de consolation.
Pendant que je mâchais ce réconfort modeste, ma langue m’est revenue. Pas celle des livres. Pas celle des discours. La vraie. Celle qu’on parle quand on n’a plus d’effort à faire. La langue de l’essentiel. Celle qui n’a pas peur de dire : j’ai mal, mais je suis encore là.
Et pendant que je mangeais, pendant que je pleurais, la montre restait à mon poignet. Pas pour me rappeler l’heure, mais pour me rappeler que, malgré tout, j’existe. Que je suis vivante. Même cabossée. Même silencieuse. Et qu’il y a dans cette montre, achetée sans raison valable, quelque chose de moi : mon désarroi doré, ma tristesse portée haut, mon luxe inutile, ma solitude habillée d’or.
Oui, j’ai pleuré aujourd’hui, la montre au poignet. Et peut-être que c’était beau. Ou peut-être que c’était juste… humain.
Odalys



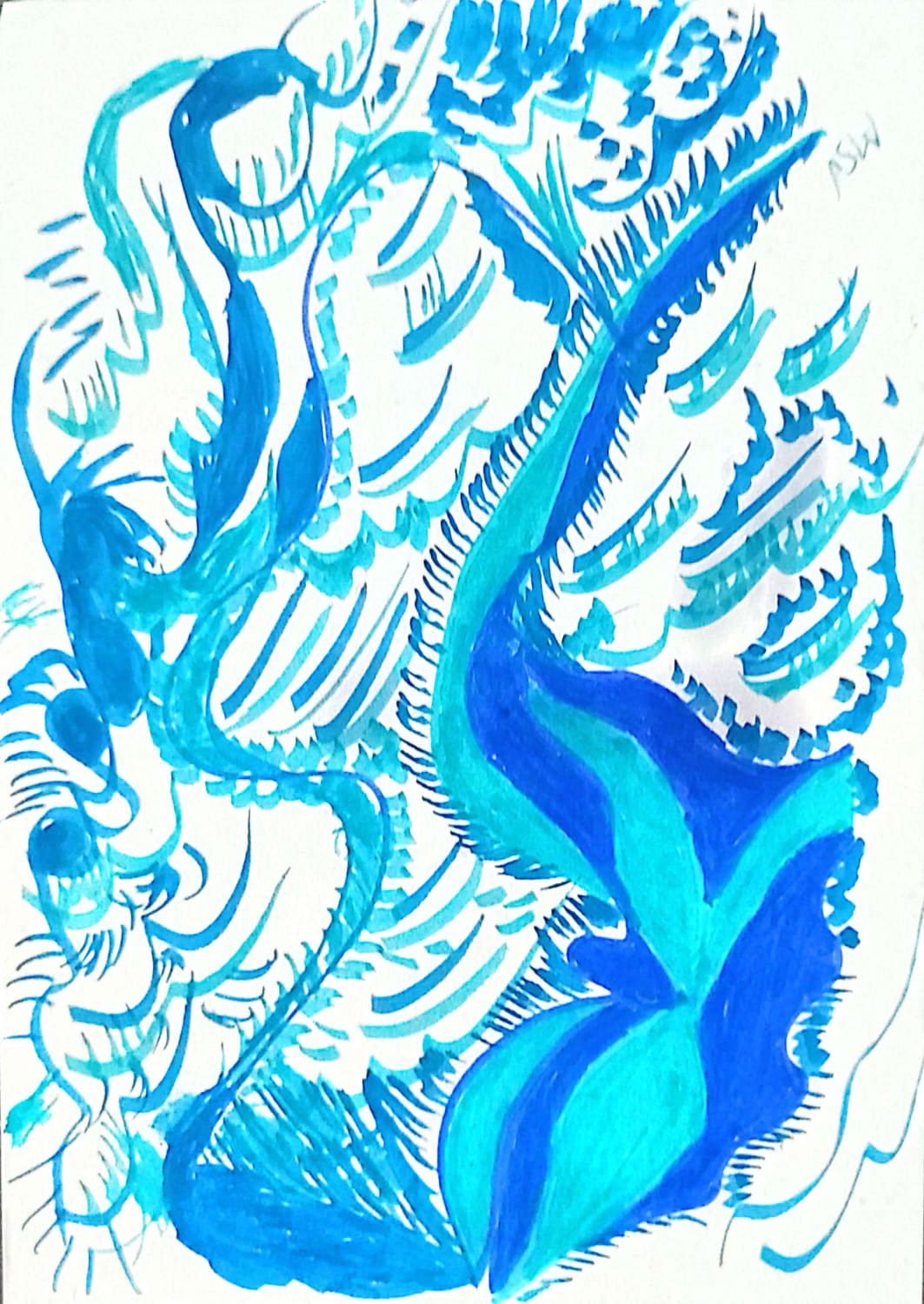

Comments 0