L’empire des dessous…

Par Houda Elfchtali
———————
Il y a, sous chaque lit du monde, un empire invisible. Un territoire silencieux, fait de moutons gris, de fils emmêlés, de miettes d’histoires. Là-bas, le balai hésite, l’aspirateur gémit, la main recule — et pourtant, tout ce que nous avons fui s’y retrouve, dans un calme sans fond. La poussière, cette mémoire éparse, nous attend. Elle sait.
Sous mon lit, j’ai retrouvé un jour une boucle d’oreille seule, une lettre en ruine, un billet de train froissé, un bouton d’enfance. Tous portaient une poussière ancienne, fine comme un voile d’oubli. Ce n’était pas sale : c’était sacré. J’ai compris alors que la poussière sous le lit est une bibliothèque de Babel miniature, à la Borges. Chaque grain contient une phrase que j’ai dite trop vite, un silence que je n’ai pas su tenir, une pensée que j’ai abandonnée avant de l’écrire.
Georges Perec, lui, aurait su en faire l’inventaire. Il aurait compté les grains, décrit leur position exacte par rapport à la table de chevet, noté la provenance probable d’un fragment de chocolat oublié. Il aurait tout archivé, tout classé, jusqu’à rendre la poussière digne d’un musée. Dans son monde, même l’insignifiant possède un droit à la mémoire.
Kafka, lui, aurait entendu les gémissements d’un insecte dans ces profondeurs. Un Gregor Samsa oublié là depuis trop longtemps. Car oui, la poussière sous le lit est aussi un refuge pour les métamorphoses ratées. Ce que nous avons refusé de devenir s’y cache encore, recroquevillé. Les rêves inaboutis, les cris étouffés, les métamorphoses avortées y dorment ensemble, dans l’ombre basse.
Un jour, j’ai imaginé qu’un écrivain minuscule s’était installé sous mon sommier, armé d’un crayon d’allumette. Il écrivait sur des pelures d’oignon des romans impubliables. Ses histoires n’étaient lisibles qu’en éternuant. Chaque éternuement soulevait un chapitre.
Pourquoi, alors, avons-nous tant de hâte à faire place nette ? À repousser la poussière comme une offense ? Elle est pourtant la preuve que le temps a passé, que les choses ont vécu, que l’air lui-même a eu une vie. Elle est notre sablier horizontal.
Et puis, il y a cette poussière qui n’est à personne, qui s’infiltre en nous sans demander la permission. Celle des villes anciennes, des palais démolis, des maisons pleines de soupirs. On la ramène dans nos cheveux, sous nos chaussures, dans nos sacs. Elle voyage avec nous, sans visa, sans passeport. Elle fait de chaque lit un carrefour du monde, une carte muette. Un peu de poussière de Fès sous un lit de Tanger. Un soupçon d’Orient dans un coin d’Occident. N’est-ce pas là une étrange fraternité, une poésie de la dispersion ? Peut-être que la poussière nous unit plus que les langues ou les frontières.
Il faudrait peut-être, une fois l’an, se glisser à plat ventre et contempler ce dessous du monde. Écouter le silence des objets perdus. Lire ce qui s’écrit dans l’ombre. Et peut-être, en se relevant, balayer non pas pour effacer, mais pour honorer dans d’ autres ailleurs .



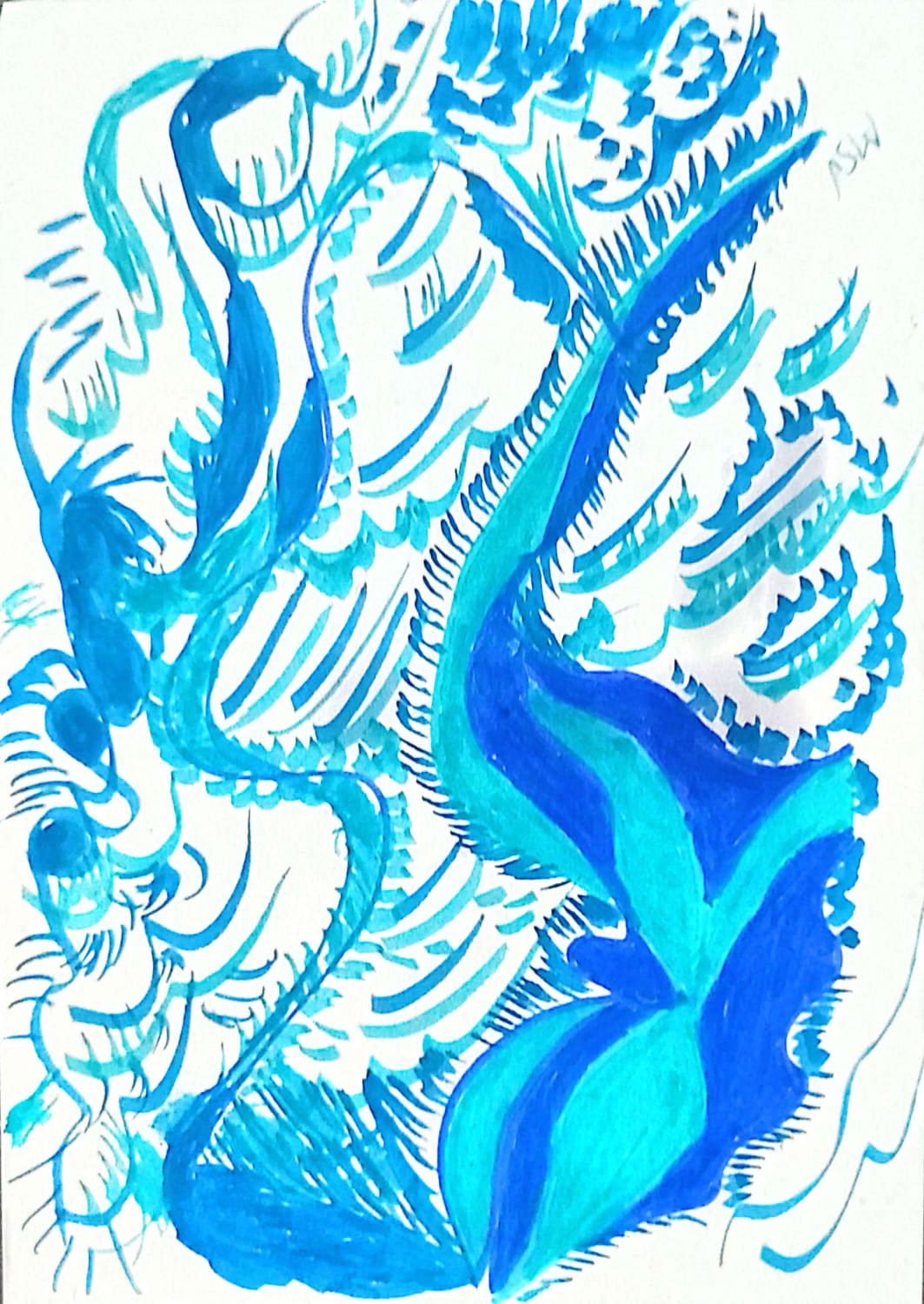

Très belle production Houda.Bravo et bonne continuation.