Les manipulations langagières de la doctrine dominante
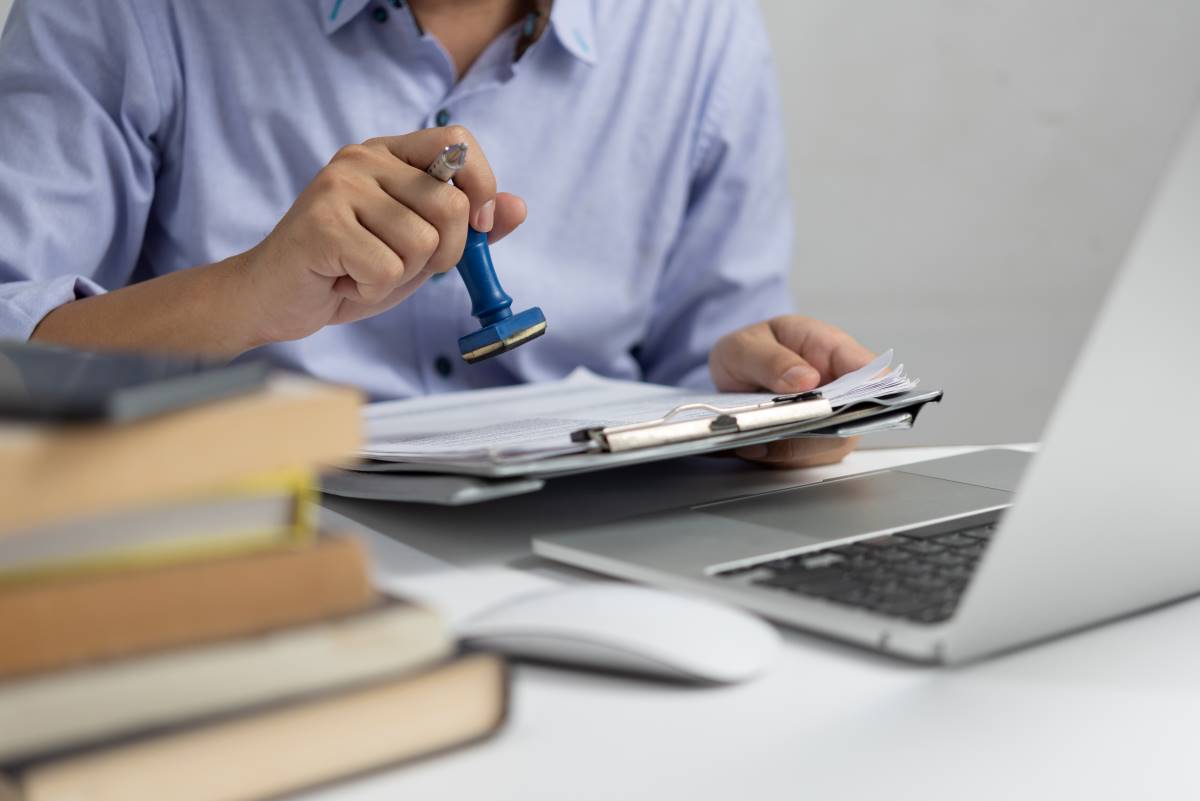
Par Docteur Belkassem Amenzou
Le remplacement des appellations a été le changement principal et le signe le plus significatif du nouveau système de gestion qui a démarré dans les multinationales au début des années quatre-vingt avant de gagner l’ensemble des secteurs privés et publics dans plusieurs pays.
Il s’agit d’un système qui propose «de devenir excellent et de se réaliser» au travail, mais qui mène doucement à l’exclusion et à la précarité, voire même au suicide. Dans ce système, les travailleurs ne comprennent plus le sens de ce qu’ils font et de ce qu’on leur demande de faire, résume Vincent de Gaulejac, sociologue et professeur des universités émérite français, dans son célèbre ouvrage «L’emprise de l’organisation».
Il explique comment la «révolution managériale» a emballé l’aliénation, sous toutes ses formes, sous de nouveaux concepts «doux» pour favoriser la production et de nouvelles formes d’esclavage moderne. Par cette manipulation du langage, révèle-t-il, on ne parle plus de «licenciement», mais de «plan social». On n’utilise plus le mot «chômeurs», mais de «diplômés à la recherche d’emploi».
De même, une politique de suppression des emplois est appelée un «plan de sauvegarde d’emplois». On n’emploie plus l’expression du «service du personnel», mais de «ressources humaines». Ainsi, explique-t-il, l’élément humain devient une «ressource» comme toutes les autres utiles et indispensables au fonctionnement de l’entreprise.
Par cette logique, conclut Vincent de Gaulejac, la formule selon laquelle «le développement économique devait être au service du développement social» ne tient plus pour céder la place à la manœuvre d’aujourd’hui selon laquelle «le développement social est au service du développement économique».
Une conclusion que confirment les statistiques des instances mondiales aujourd’hui, en révélant que «les 1% les plus riches de la planète possèdent près de la moitié des richesses mondiales». Dans ce contexte, force est de constater que le travail d’aujourd’hui retrouve son sens d’antan, mais emballé dans des concepts doux. Le terme «travail», apparu au 12è siècle, est dérivé du mot «travailler», issu du latin «tripaliare», qui signifie torturer, tourmenter… Le grand mal est que toutes ses «souffrances» (travail) ne servent même pas aujourd’hui à remplir le réfrigérateur. «Survivre» au lieu de vivre.





Comments 0