Le concept de l’information : un enjeu civilisationnel

Par Samir Ghalib, enseignant-chercheur
——————————————————-
Résumé : cette communication a pour but d’élucider le concept de l’information diachroniquement pour le situer dans son contexte socioculturel. Il s’agit d’un élément crucial pour reconstituer les différentes étapes du devenir humain et surtout pour mieux comprendre l’actualité d’une société dite de l’information.
Mots-clés : concept de l’information, duplicité, transdisciplinarité, signe, relation, possibilités nouvelles, société de l’information, connaissance, NTIC, enjeu civilisationnel.
Le concept de l’information se pose comme un constituant matriciel autour duquel s’organise la culture de nos jours beaucoup plus qu’à un tout autre temps. Il s’agit d’un support actif qui a conditionné le développement humain et l’institution des civilisations. L’article présent met à profit le gain d’intérêt dont jouit le concept actuellement pour en faire l’objet de son étude, exploitant la diachronie pour le replacer ensuite dans le contexte présent se caractérisant par la forte présence des technologies de l’information et de la communication.
Notion problématique
Quand on prétend définir le concept de l’information, on se trouve d’emblée dans une situation problématique. Il s’agit en l’occurrence de donner la signification à ce qui notionnellement représente le sens lui-même ou une particule du sens, car comme on peut le dire tout est information. Cette autodéfinition, ou définir la chose par elle-même n’est que tautologie. Pour la caractériser-l’information- on peut recourir à ses attributs majeurs. Elle se définit comme nouveauté, saillance et rupture avec ce qui précède. Bien que son occurrence change un ordre de choses, elle ne donne rien de définitif dans un monde toujours en mouvement. Des siècles durant, des théoriciens se sont évertués à fixer le contenu de cette notion qui semble résister à l’effort définitionnel parce qu’elle relèverait du domaine de l’évidence. On se trouve d’emblée livré à des questions incontournables : comment peut-on définir l’information ? Comment s’est-elle développée à travers l’histoire ? Quelle place occupe-t-elle dans le contexte présent et quels sont les enjeux qu’elle représente ?
Déjà quand on tente de restituer sa signification, un passage par l’histoire ainsi que les différentes sciences qui s’y sont intéressées semble à propos avant de contextualiser cet objet étudié dans une actualité investie par les nouvelles technologies. Mais pour commencer la lexicologie nous permettra de reconstituer diachroniquement les différentes significations de cet item. Car l’information est un concept qui se construit sur une duplicité basique.
Le dictionnaire Larousse propose -entre autres usages spécifiques-quatre acceptions pour expliquer le mot. Les quatre sens exposés diachroniquement restituent les significations successives et les mutations du sens qui ont ponctué son évolution. Mais pour comprendre l’importance capitale que revêt l’information, il faudrait se consacrer à son étymologie. Ce lexème se compose d’un préfixe et d’un radical : in /form, ce qui dénote l’action de mettre en forme un contenu ou de donner sens à un fait du monde extérieur pour en faire un élément intelligible, compréhensible par l’entendement, traitable par la mémoire.
L’article du dictionnaire propose différentes significations que nous avons organisées par référence à l’histoire afin de toucher l’évolution du sens du vocable.
- Instruction préparatoire, diligentée par le juge d’instruction en vue de rechercher et de rassembler les preuves d’une infraction, de découvrir l’auteur, de constituer à charge et à décharge le dossier du procès pénal. (Elle est close par un non-lieu ou par un renvoi devant une juridiction répressive. En matière criminelle, l’instruction est à double degré [juge d’instruction, chambre d’accusation
- Indication, renseignement, précision que l’on donne ou que l’on obtient sur quelqu’un ou quelque chose : Manquer d’informations sur les causes d’un accident. (Abréviation familière : info.)
- Tout événement, tout fait, tout jugement porté à la connaissance d’un public plus ou moins large, sous forme d’images, de textes, de discours, de sons. (Abréviation familière : info.)
- Élément de connaissance susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être conservé, traité ou communiqué. Unité de base d’un signal (Bit) ou capacité de stockage. Quantité d’informations dépourvue de sens (s’oppose à redondance).
On voit bien que les sens évoluent selon une logique bien déterminée. En effet, on commence avec l’action ou l’opération de chercher un contenu ; et puis on passe métonymiquement de l’opération au contenu dont elle constitue la quête. C’est-à-dire qu’on transite de l’opération de chercher un contenu à ce contenu intrinsèquement. Après, l’emploi de l’item s’étend et ‘’s’objectivise’’ par un élargissement de la signification. Et enfin par une contamination sémique sous l’effet grandissant des technologies de l’information et de la communication, celle-ci se quantifie et se transforme en unité de mesure qui est le bit et se vide du contenu intelligible pour se charger d’un contenu numérique. Ainsi, il semble que le concept subit toute une migration sémique conditionnée par le flux de l’historicité. La logique de cette mutation sémique va dans le sens de l’évacuation du rôle du sujet humain, récepteur. En fait, pour être plus exact, on dira que ce mouvement œuvre dans le sens du remplacement de l’homme par la machine qui désormais chiffre et déchiffre numériquement le sens.
En l’occurrence, le dynamisme du concept participe à son opacité. En évacuant la part qui sied au sujet observateur, on le -ce concept- pose autrement. Il n’est plus pour autant cette particule intelligible de contenu à l’adresse et à l’intention d’une conscience pour servir de biais entre extériorité- le réel, et intériorité-le sujet pensant. L’information remplissait un rôle social favorisant le cumul des données nouvelles pour produire un état de connaissance. Cette fonction empirique qui la tenait dans un rapport de dépendance au sujet pensant s’atrophie pour lui donner un autre statut ontologique d’inhérence. Cette duplicité nouvelle se trouve à l’origine de la confusion entre information et communication. Cette inhérence parait émanciper l’information de la dichotomie information/communication en faisant l’économie de l’intention de communiquer, par la quasi éviction du rôle du sujet (locuteur-allocutaire). Mais parallèlement et dans ce même contexte historique et culturel, conditionné par le développement de l’informatique et des nouvelles technologies, nous assistons à un surcroit de duplicité par l’usage du champ notionnel de l’information incarné par la triade : Donnée, information, connaissance. Décidément, ces termes sont plus à l’usage de nos jours et affichent une redistribution dans les schémas conventionnels de nos médiums. En devenant une unité quantifiable numériquement, l’information est désormais perçue sur une échelle de trois niveaux allant du plus simple au plus construit. En l’occurrence, la donnée serait le niveau le plus simple et le plus mécanique pour transiter sur l’information qui est le niveau médian pour enfin se constituer en connaissance. Ce sont des niveaux de collecte et d’interprétation de la matière de l’information de la part d’un sujet qui cherche à comprendre la réalité environnante pour y agir de manière optimale.
Comme le soutient Thomas C. REDMAN dans son ouvrage La qualité des données à l’âge de l’information, 1998, PP. 195-211, les données sont des groupements de faits, le substrat de l’information ainsi que des substituts aux objets du monde réel. Elles relèveraient d’un constat direct prélevé sur la réalité, transcrites et chiffrées pour être comprises et déchiffrées ultérieurement. Cependant, pour que cette définition soit complète faudrait-il ajouter que ces données sont considérées intrinsèquement et en autonomie d’un utilisateur potentiel.
Quant à l’information, elle procède de la donnée à laquelle s’ajoute son interprétation actualisée par une personne ou un groupe de personnes. Comme le démontre Karl E.WEICK dans ses recherches entre 1993 et 1995, ce niveau de signification est beaucoup plus marqué par le contexte général de l’interprétation ainsi que les caractéristiques personnelles du sujet l’effectuant.
Selon Ikujiro NONAKA, dans son ouvrage théorique The knowledge creating company, 1995, la transition du concept d’information à celui de connaissance implique des opérations plus élaborées pour permettre l’accès à un niveau de cognition. A ce stade, le sujet réalise une organisation des informations selon un ordre et une logique donnés pour dégager des lois générales afin de se garantir une meilleure appréhension de la réalité. C’est également le lieu où s’effectue, par un procédé d’apprentissage, le passage d’une connaissance nouvelle au statut de connaissance acquise. Il en résulte une modification générale qui influencerait la conception du monde de la personne concernée.
Fritz MACHLUP fait également référence à cette duplicité constitutive du concept et cela dès les premières lignes de son ouvrage théorique.
« Linguistiquement, la différence entre la connaissance et l’information tient pour l’essentiel au verbe « former » : « informer » est une activité par laquelle la connaissance est transmise ; « connaître » est le résultat d’avoir été informé. « Information » comme acte d’informer, c’est produire un « état de connaissance » dans l’esprit de quelqu’un […] La différence ne réside dans les termes que lorsqu’ils doivent se référer respectivement à l’acte d’informer et à l’état de la connaissance » [Machlup, Production and Distribution of Knowledge in the United States, 1962, p. 15]
De surcroît, le mot connaissance cultive une polyphonie fondamentale dans la mesure où il renvoie aussi bien de la connaissance comme quête et comme effort pour réaliser l’état de connaissance comme il pourrait qualifier le résultat final d’une connaissance acquise. On dirait que ce concept est perméable au sens et dans tous les sens ce qui participe à la création d’un état ambigu se posant d’emblée comme de l’ordre de l’évidence mais résistant à tout effort définitionnel.
Un concept transdisciplinaire
Si l’information se constitue à la lumière des éléments qu’on vient d’exposer comme le vecteur de l’accumulation du savoir, elle est à la fois l’outil et le résultat de la connaissance. Ce qui explique son rapport inextricable avec les sciences. Ces sciences représentent l’articulation académique et la réalisation institutionnelle de la connaissance humaine. Bien qu’elles soient toujours alimentées par l’apport cumulé de l’information pour en faire la connaissance, à un moment donné de l’histoire ces sciences- aussi bien exactes qu’humaines- s’étaient trouvées obligées de se pencher sur leur outil conventionnel pour en faire l’objet de leurs investigations. L’humanité avait alors atteint la phase critique de son savoir qui devait être réévalué dans un autre contexte et selon de nouveau présupposés.
De prime abord, il faut sans doute constater que ce concept se trouve au carrefour des représentations scientifiques. Seulement, il est appréhendé différemment de la part des sciences dites cognitives telles que d’abord la philosophie, et ensuite la linguistique, l’anthropologie, la psychologie, l’intelligence artificielle et les neurosciences et encore plus pour généraliser, de la part des sciences dites humaines. Toutes reconnaissent l’information comme essence subjective nécessitant obligatoirement la présence d’un tiers. Toutefois, c’est sous un autre éclairage que les sciences dites exactes tentent de l’approcher. Celles-ci l’établissent comme une valeur objective et mesurable. On constate que dès la date de 1920, des sciences exactes telles que la physique, les statistiques et les télécommunications l’associant à leurs domaines de définition respectifs : l’entropie pour la physique, les probabilités pour les statistiques et le bruit pour les télécommunications. Ces disciplines se rendent à l’évidence que la nature de l’information contraste avec l’entropie, le signal et la probabilité. Elle est foncièrement anti-entropique par son immatérialité, discontinue et improbable.
Pendant l’année 1948, un ingénieur en téléphonie travaillant pour la société BEL, Claude Shannon lance la publication de la théorie mathématique de la communication, où l’information se transmet comme un signal s’articulant comme une logique de redondance improbable. Parallèlement, Norbert Wiener publie Cybernetics and society à la même année, promulguant les règles d’une discipline nouvelle. La cybernétique explique le fonctionnement de l’information dans l’autorégulation de toute structure. Elle érige la particularité de l’information avec son principe de résistance à l’entropie. La transmission de l’information serait le catalyseur activant la boucle de rétroaction négative. Celle-ci est à l’origine de la plupart des régulations biologiques dans les organismes vivants et des automatismes pour les structures et machines se normalisant sur leur effet. C’est de cette manière que La théorie de l’information fera alors son entrée à effet dans la biologie, l’économie, la sociologie, l’anthropologie…
Avec la prise de conscience de la complexité du monde ; une complexité qui se fait d’autant plus sensible avec le progrès technologique et le développement scientifique, la théorie des systèmes apparait au milieu du XXème pour s’intéresser à la réalité comme une structure où s’amalgament des flux d’informations, de matières et d’énergie. Des circuits alambiqués qui interagissent et s’autorégulent par référence à un code d’information circulante et information-structure (ADN). L’approche systémique apparait alors comme pour pallier à l’approche analytique trop limitative, puisque cette dernière prend chaque élément en l’isolant des autres constituants du même système. Plus tard, les théories de la complexité se focaliseront davantage sur les attributs de l’information : son imperfection, sa non-linéarité, son imprévisibilité. C’est une composante discontinue qui opère dans un monde en perpétuel changement, ainsi le résultat qu’elle provoque demeure flou et précaire. Ce qui explique le fait que l’informatique soit constituée sur un codage binaire car c’est le domaine qui conjugue la totalité et la nullité, une démarche sans nul doute plus logique que mathématique.
On dirait que plus ces sciences nouvelles prennent conscience de la complexité du monde plus on ressent un besoin pressant en matière d’information, outil nécessaire pour gérer la réalité ainsi que les problèmes qui occurrent. Mais c’est surtout le moyen radical pour s’assurer de garder le contrôle sur le monde.
L’information comme signe et comme relation
Autre propriété essentielle de l’information est en effet son caractère de signe. Elle sert une fin de signification à l’intention d’un récepteur donné. Ainsi, elle serait indirecte et renverrait à autre chose. Cette propriété la différencie sensiblement de la matière et de l’énergie, qui obéissent à un principe d’inhérence. Elle n’est pas en conséquence une notion physique. Déjà, de par son improbabilité et sa discontinuité, l’information part dans une logique contraire à la continuité du signal physique ou des lois mathématiques.De même, et à l’inverse de l’énergie d’une force physique, il n’y a, en aucune façon, proportionnalité entre une information et ses effets. Par exemple, un signal électrique infinitésimal peut gérer ou déclencher une force très importante. Ce manque de proportionnalité est le résultat direct de la productivité incommensurable des technologies informatiques.
Bien que le concept d’information se définisse surtout comme signe conventionnel indiquant un signifié qui lui est extrinsèque, ce signifié en question ne peut être actualisé en dehors de la contribution d’un sujet. De-là le caractère foncièrement subjectif de l’opération. La concrétisation de l’information s’organise autour d’un code défini qui sera déchiffré par un récepteur qui devrait à son tour avoir le même référentiel culturel. Conséquemment, l’information est qualitative, elle est relation puisqu’elle présuppose l’association et l’interaction entre plusieurs éléments. De même et pour les mêmes raisons une information peut être sujette à plusieurs lectures et actualisations. L’activité significative de toute information développe une bonne part de polysémie.
L’information devient communication lorsqu’il y a intention de communiquer. Cela suppose également la possibilité de feedback et d’échange. Ce schéma nécessite l’existence d’un émetteur, d’un récepteur, d’un langage commun ou code, et d’un référentiel symbolique et culturel commun dans les échanges les plus élaborés. L’information n’est pas une donnée autonome d’un objet donné, elle fait plutôt partie d’un vaste ensemble connectant émetteur physique et récepteur dans un sens biologique. Elle se définit également comme rapport et dépendance, variation et structuration dans un système. Comme elle peut s’articuler à un niveau superstructurel en tant que cognition, apprentissage et surtout adaptation. L’information est essentiellement liée à l’expérience empirique et ontologique d’un sujet en quête de conditions de vie optimales dans un monde changeant. Elle est inamovible d’un sentiment organique d’incertitude voire d’inquiétude qu’elle ne peut dépasser mais qu’elle peut toujours réduire dans la précarité du réel. La signification d’une information est toujours fonction d’un sujet, d’une histoire, d’un contexte culturel.
Le caractère conventionnel et purement indiciel de l’information l’inscrit comme l’antipode même de la matière et de l’énergie. C’est ainsi qu’elle échappe à l’entropie. La matière périssable et l’énergie épuisable demeurent dans un rapport de dépendance par rapport à l’espace, au temps et aux relations physiques de cause à effet. Alors l’immatérialité informationnelle la dérobe aux préjudices de l’entropie. Avec la numérisation informatique, l’information devient mesurable, quantifiable. Son traitement, stockage et usage offrent plus de malléabilité. Elle acquiert une nouvelle opérationnalité, résistant aux relations de causalité, de proportionnalité et de spatio-temporalité. La différence entre l’information et l’élément auquel elle renvoie la tient à l’écart de la déperdition matérielle lui permettant une reproduction à l’identique à un cout quasi nul. Par un code binaire, une suite de 0 et 1, elle peut être transmise instanément partout autour du globe sans coût ni perte de données. Jamais pareille ergonomie n’a été atteinte à travers l’histoire.
En effet, l’ère du numérique pare le concept de l’information de nouvelles fonctionnalités. Ce fut comme une révolution. Il se profile comme un concept libre échappant aux limites conventionnelles de la matière et de l’énergie. L’information est alors appréhendée du point de vue de Kenneth J. Boulding (1952) président de l’Académie des sciences de New York «comme une nouvelle dimension de la matière, au-delà de la masse et de l’énergie. ». Ce concept est mitoyen au biologique, linguistique et technique… tout domaine reste tributaire de l’information.
Improbabilité, rareté et pertinence.
Nous revenons maintenant sur les qualités de l’information qu’on a déjà nommées plus haut mais que nous n’avons pas explicitées suffisamment. Vu leur importance et la complexité des processus qu’elles impliquent, nous avons jugé plus convenable de leur consacrer une rubrique particulière. Décidément, une information réfère toujours à un ordre de choses qui se détache de la norme et de l’habitude. De-là, son improbabilité. Elle est saillance et rupture avec un ordre donné qu’elle reconstruit par son occurrence. Cet aspect imprévisible est l’essence même informationnelle apportant cette nouveauté qui renégocie l’ordre des choses. C’est de cette façon qu’elle peut ôter ou du moins atténuer l’incertitude que nous éprouvons à l’égard des choses et du monde. Puisque nous vivons dans une histoire et dans un flux évènementiel se caractérisant foncièrement par l’imprévisibilité, l’information est censée restituer cette part de nouveauté et de variation pour être en concomitance avec le branle et le changement continu du monde. Elle offre l’occasion d’une réévaluation et d’une mise à jour des données que nous avons de notre vécu. C’est de cette façon que nous avons l’opportunité d’optimiser les conditions de notre existence dans une réalité toujours en mouvement. Nous retrouvons cette propriété à la base de la régulation et des rétroactions développées par la cybernétique. Cependant, l’information n’apporte rien de définitif. Chaque évènement qui a lieu sous le soleil apporte un ordre nouveau et des considérations nouvelles dans la réalité. Et puisque l’information porte sur un monde changeant, elle est soumise à la logique du transitoire et de la caducité. Donc elle ne peut se soustraire à une imperfection organique.
Edgar MORIN propose une théorie de l’information dans laquelle il fait la part de la complexité, le dynamisme et le redéploiement notionnel et technique qui se trame autour de ce concept matriciel. Il est désormais un moyen de contrôle de l’énergie, mais également source d’autonomie :
« Ce concept d’information permet d’entrer dans un univers où il y a à la fois de l’ordre (la redondance), du désordre (le bruit) et en extraire du nouveau (l’information elle-même). De plus, l’information peut prendre une forme organisatrice (programmatrice) au sein d’une machine cybernétique. L’information qui indique, par exemple, le vainqueur d’une bataille, résout une incertitude ; celle qui annonce la mort subite d’un tyran apporte l’inattendu, en même temps que la nouveauté. » [Penser la complexité in Sciences humaines, n°47, février 1995]
L’information est surtout construction, connaissance indirecte des choses. C’est ainsi qu’elle ne peut s’auto-suffir de façon immanente. Elle obéit à des fins de connaissance et de re-connaissance. Elle est appropriation de l’extériorité. Elle se profile en son origine à l’instar d’une réaction contre un manque d’information. C’est-à-dire qu’elle est faite sur commande pour suppléer à un manque qu’éprouve le sujet pensant vis-à-vis du monde. Tout renseignement procède d’une reproduction biaisée de la réalité pour corriger une incomplétude et un inachèvement. Elle sert un effort de régulation, de synchronisation- remplissement selon Husserl et accommodation selon Piaget- entre l’ordre de connaissances d’un sujet et l’état des choses dans le monde. Elle est foncièrement pertinence.
Cependant, d’un point de vue économique, l’information est surtout une valeur marchande. Elle est estimée, comme tout autre bien par référence à un principe de rareté. Elle n’est pas un bien libre tel que l’air. Mais elle n’a pas la même consistance matérielle qu’un objet. De nos jours, le marché de l’information, qui est également le marché de l’immatériel polarise les capitaux les plus exorbitants qui dépassent en toute mesure les valeurs d’une économie basée sur l’énergie.
La dichotomie énergie/ information
L’information est différente de l’énergie. Cependant des relations bien étroites se nouent entre ces éléments. Si l’énergie et la matière sont des composantes directes de la réalité immédiate, l’information procède d’une connaissance indirecte de cette réalité. Elle n’est pas un constituant direct de la réalité, mais en est la description. Elle rend en effet compte de l’état de la matière et de l’énergie en fixant ses attributs : forme, vélocité, orientation, organisation…
Il n’y a, en aucun cas, parité ou égalité entre les trois entités. Matière et énergie participent à -ou constituent-le monde empirique, l’information n’en est que le simple rapport. Sans l’énergie ou la matière, l’information n’a plus de raison d’être. L’essor de la physique quantique a amené certains physiciens zélés à réduire la matière à la simple information. Ce qui était une erreur méthodologique. Leur méprise se justifie du simple fait que sans information nous n’avons aucune possibilité d’accès à la matière. Au-delà de leur différence basique, ces éléments sont inséparables et interdépendants.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’information qui n’est que le signe de la chose ne subit pas la loi entropique qui définit le monde physique ; mais cette propriété sera encore plus prononcée avec le développement de l’informatique et du réseau internet. Le codage numérique binaire offre le moyen idéal pour la transmission et la reproduction de l’information, de façon illimitée, toujours à l’identique, au-delà de l’entropie et de la perte des données, avec un coût quasiment nul. Ce qui a encore creusé l’écart entre information d’une part et la matière et l’énergie de l’autre. On parle déjà d’une «révolution numérique» qui sonne la fin de la société de l’énergie et du principe de l’entropie. Néanmoins, il ne faudrait surtout pas penser qu’aujourd’hui, le monde se passe d’énergie parce qu’il lui a trouvé un substitut. Nous vivons bien dans un monde empirique où l’idéel et la connaissance ne peuvent remplacer la matière et l’énergie. L’information se propose comme le moyen idéal pour contrer une économie libérale centrée sur la rareté, le monopole des richesses et des moyens de production. C’est une phase nouvelle plus raisonnée où l’on procède par le management de l’information pour aboutir à une meilleure gestion des ressources. Il est question de prendre le contrôle pour définir l’organisation et les conditions optimales d’un vécu plus sûr et plus adéquat pour tout le monde. Le développement humain s’est réalisé de façon corrélative d’une gestion de l’information que l’on peut classer du plus simple au plus élaboré d’abord comme simple codage biologique ADN dopant les instincts basiques de survie et d’auto-préservation de l’espèce, au logos et langages contigus, au codex -l’écrit, à l’image statique et dynamique, au numérique. Des périodes où l’information est transmise de plus en plus vite et de façon tendant progressivement vers l’optimal.
De nos jours, après la révolution numérique, l’information est devenue plus maniable concernant sa production-et reproduction, sa transmission, son stockage et son usage. Cette flexibilité des données offre des moyens de contrôle sur le monde qui redéfinissent nos rapports avec le temps, l’espace, la matière. Partout dans le monde, de puissants systèmes numériques sont lancés jour et nuit procédant à une collecte de données pour une sélection de l’information rendant possible une régulation en tout instant par correction des erreurs, gestion de et rétroactions. Un laboratoire rétroactif régissant les régulations et plaçant l’homme aux commandes, à l’échelle planétaire.
« Qui a l’information a le contrôle » cette sentence n’a jamais été aussi vraie que de notre temps. Les faibles coûts de l’industrie de l’information définissent de nouveaux rapports de production. Dans cette mouvance nouvelle, l’histoire humaine se fait de plus en plus fluide et échappe aux anciens schémas rigoristes d’une société énergétique basée sur l’hégémonie de la matière, de la masse, de la hiérarchie… pour un ordre plus flexible où chaque élément, quel que soit son importance, peut changer macroscopiquement et historiquement la donne.
En partant d’un modèle économique bâti sur l’énergie vers un modèle plus ouvert sur les possibilités nouvelles qu’offre l’ère informationnelle numérique, l’humanité semble découvrir des médiums plus ergonomiques lui permettant de sortir de la contrition d’un capitalisme rapace aux circuits figés. L’aménagement- ou réaménagement- des données informationnelles à base de correction d’erreurs et de régulation construit une économie plus fluide avec des paramètres plus flexibles. Certains théoriciens parlent déjà d’économie de l’information qui serait un correctif de celle de l’énergie. Cette nouvelle structure économique pourrait poser la pierre angulaire pour un mode civilisationnel nouveau construit sur un aménagement des besoins par la pratique d’un pilotage par l’information proches des écosystèmes complexes, lucide, responsable et autorégulé pour maintenir à tout instant un équilibre planétaire entre faune, flore et société humaine.
La mutation numérique a apporté nombre considérable de changements, il faut préciser qu’il s’agit surtout d’un changement catégoriel qui touche les structures de la société. Internet, l’informatique, et le développement des réseaux relatifs à la téléphonie ont modifié notre conception du temps, de l’espace, du travail, de la hiérarchie, de la propriété, de l’organisation… des modifications qui œuvrent dans le sens de l’ouverture des possibilités humaines pour l’accession à un statut supérieur. Placer l’homme aux commandes de l’univers, pour procéder à un management général…
C’est un projet qui semble faire l’unanimité et qui bénéficie du soutien des pays développés. Ce qui justifie le fait qu’il soit instamment promu dans les médias et dans la littérature journalière qui tisse la trame de notre culture. Des capitaux intéressants sont débloqués pour financer cet atelier. Un atelier supervisé par toute une pléiade de théoriciens : économistes, sociologues, cybernéticien, spécialistes en techniques de l’information et de la communication…
Un enjeu civilisationnel
On ne va pas détailler la nature et les effets des modifications apportées par les nouvelles technologies et qui procèdent de l’avènement de la société de l’information, faute de temps. Une littérature bien prolixe a étendu cet aspect ; notre objectif est de replacer ce concept de l’information dans une perspective autre. Les représentations panégyriques et idéalisantes posent ce concept comme la panacée de tous les maux et la clé à toute espérance. Tout projet a ses limites de réalisation par rapport à un idéal. Il est toujours temps de poser des questions pertinentes et nécessaires qui ont trait à notre devenir. Jusqu’à quelles mesures ce modèle peut-il assurer et garantir la prospérité matérielle et éthique escomptées ? Sommes-nous déjà cette société de l’information ? Sommes-nous dans une logique de bonne gouvernance par l’aménagement des nouvelles technologies de l’information et de la communication ou plutôt, sommes-nous soumis à un déterminisme techniciste opaque ? Quelles garanties avons-nous pour que ce modèle ne se corrompe pour promouvoir le même libéralisme sauvage mais avec des moyens encore plus efficaces et des frais encore plus coûteux pour l’humanité ?
Ce sont les questions les plus urgentes auxquelles nous devrions nous consacrer ces temps présents. Cet article ne prétend pas trouver des réponses pour un questionnement aussi crucial. Notre civilisation, le devenir de l’humanité en sont les véritables enjeux. Nous avons jugé nécessaire de porter la lumière sur une notion basique pour comprendre l’actualité. Les grands projets naissent dans le zèle mais c’est dans l’action pondérée qu’ils trouvent leur réel accomplissement. Le développement technologique ne peut être au service de la société que quand il est accompagné par un degré correspondant de conscience et d’éveil des membres d’une société donnée, sinon il se tournerait en dépossession et en déterminisme. Car on ne peut tirer le meilleur tribut d’un médium que quand on est habilité à le faire, autrement, on se retrouverait dans un scénario de renversement de situation où le sujet deviendrait l’objet de son invention. On ne peut conduire et piloter que si l’on a la formation requise. Formation que l’on acquiert par l’information-notre choix du thème pour cet article n’est pas hasardeux. L’adage populaire dit : un homme avisé-informé- en vaut deux. On sait aujourd’hui qu’à l’échelle humaine, cela n’a jamais été une question de nombre mais de qualité, de conscience et de compétence. C’est de cette façon que l’individu peut sortir de son anonymat pour devenir citoyen à part entière. Peut-être que notre société présente se soucie beaucoup plus du progrès technologique que d’une habilitation nécessaire du citoyen à ce nouvel ordre des choses… la société de l’information n’est pas la somme de ses citoyen mais en représente la synergie, la participation responsable dans un flux progressif sans exclusion !
En outre, le sens commun pense que la libre circulation de l’information constitue le meilleur gage pour instituer le savoir, les compétences de l’honnête citoyen ainsi que pour instituer cette « conscience collective » dont parle LEVY dans un de ses articles publié dans le monde diplomatique sous le titre Construire la conscience collective, 1996, pp35-36 comme : mise en synergie-de l’information sur le net- en temps réel ; et qui aboutit à une mobilisation effective des connaissances.»
L’information est désormais omniprésente, illimitée. On la représente par la métaphore aqueuse (flux, vague, déferlante, débit… difficile à contenir et à canaliser. Une logique du déluge où des pages interminables disséminent l’information beaucoup plus qu’elles ne la révèlent. Une bibliothèque de Babel où tout est là, mais où tout reste à trouver. Sommes- nous déjà dans la situation où « trop d’information tue l’information » !
Encore une fois, la qualité et non la quantité. Les contenus mis en circulation sur les réseaux ne font pas l’information. L’opinion, la rumeur, les fakenews… nous remettent encore une fois sur la nécessité de l’habilitation de ces contenus et de surcroit, l’habilitation du citoyen. Celui-ci devrait être en mesure de faire le tri, de faire le meilleur usage de chaque donnée, de participer à cette conscience collective qui ne renie pas les consciences individuelles… Ainsi se construisent les civilisations !
Bibliographie
Boissonnat, J. (1995), Le travail dans 20 ans, Paris, Odile Jacob
Breton, P. (1995), L’utopie de la communication, le mythe du « village global », La Découverte, Paris.
Castells, M. (1998), La société en réseaux, Fayard, Paris.
Ettighoffer, D. (1992), L’entreprise virtuelle ou les nouveaux modes de travail, Odile Jacob, Paris.
Gates, B. (1995), La Route du futur, Robert Laffont, Paris.
Hagel, J. et Singer, M. (1999), Net Worth, Harvard Business School Press.
Kelly, K. (1998) New Rules for the New Economy, Viking Penguin Publishers.
Levy, P. (1997), Cyberculture, Rapport au Conseil de l’Europe, Éditions Odile Jacob, Paris.
Lévy, P. (1990), Les technologies de l’intelligence ; L’avenir de la pensée à l’ère informatique, La Découverte, Paris.
Negroponte, N. (1995), L’homme numérique, Robert Laffont, Paris.
Rifkin, J. (1995), The End of the Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Putnam’s Sons, New York. Traduction : Rifkin, J. (1996), La Fin du travail, La Découverte, Paris.
Rosnay, J. de (1995), L’homme symbiotique, regards sur le troisième millénaire, Le Seuil, Paris.
Rosnay, J. de (1975), Le macroscope, vers une vision globale, Le Seuil, Paris.
Scheer, L. (1994), La démocratie virtuelle, Flammarion, Paris.
Sérieyx, H. et Azoulay, H. (1996), Mettez du réseau dans vos pyramides : penser, organiser, vivre la structure en réseau, Village Mondial, Paris.
Shapiro, C (1998), Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy, Varian
Tapscott, D. et Caston, C. (1993), Paradigm Shift: The New Promise of Information Technology, McGraw-Hill, Inc., New York.
Touraine, A. (1997), Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Fayard, Paris.
Virilio, P. (1998), La bombe informatique, Galilée, Paris.
– Articles
» How to Win Big on the Net « , Fortune, 24 mai 1999
» Internet or Bust! » Fortune, 7 décembre 1998
» Managing in a Wired World « , Fortune, volume 130, n° 1, 11 juillet 1994.
» The Information Revolution, How digital technology is changing the way we work and live « , Business Week,
» Welcome to the Wired World, What the networked society means to you, your business, your country – and the globe « ,Time, numéro spécial, 3 février 1997.
» When Companies Connect: How the Internet Will Change Business « , The Economist, Cover Story, 26 juillet 1999
Edmondson, G. (1997), » A French Internet Revolution? « , Business Week, International European Business Edition, 29 septembre.
Hof, R. D. et Browder, S. (1997), « Internet Communities « , Business Week, Cover Story; 5 mai.
Judge, P. C. (1999), ‘’Internet Anxiety, Nanette Byrnes « , Business Week, Cover Story,28 juin.
juillet 1994.
Rosnay, J. de (1996), « Ce que va changer la révolution informationnelle « , Le Monde diplomatique, août.
Rosnay, J. de (1997), » La France et le Cybermonde « , le Monde Diplomatique, août.


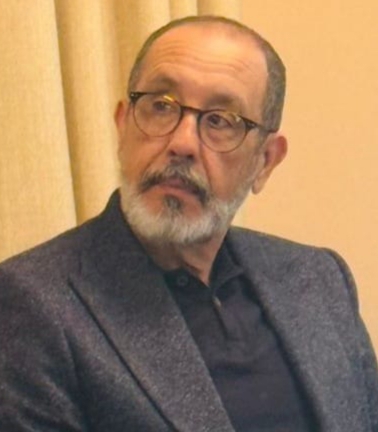
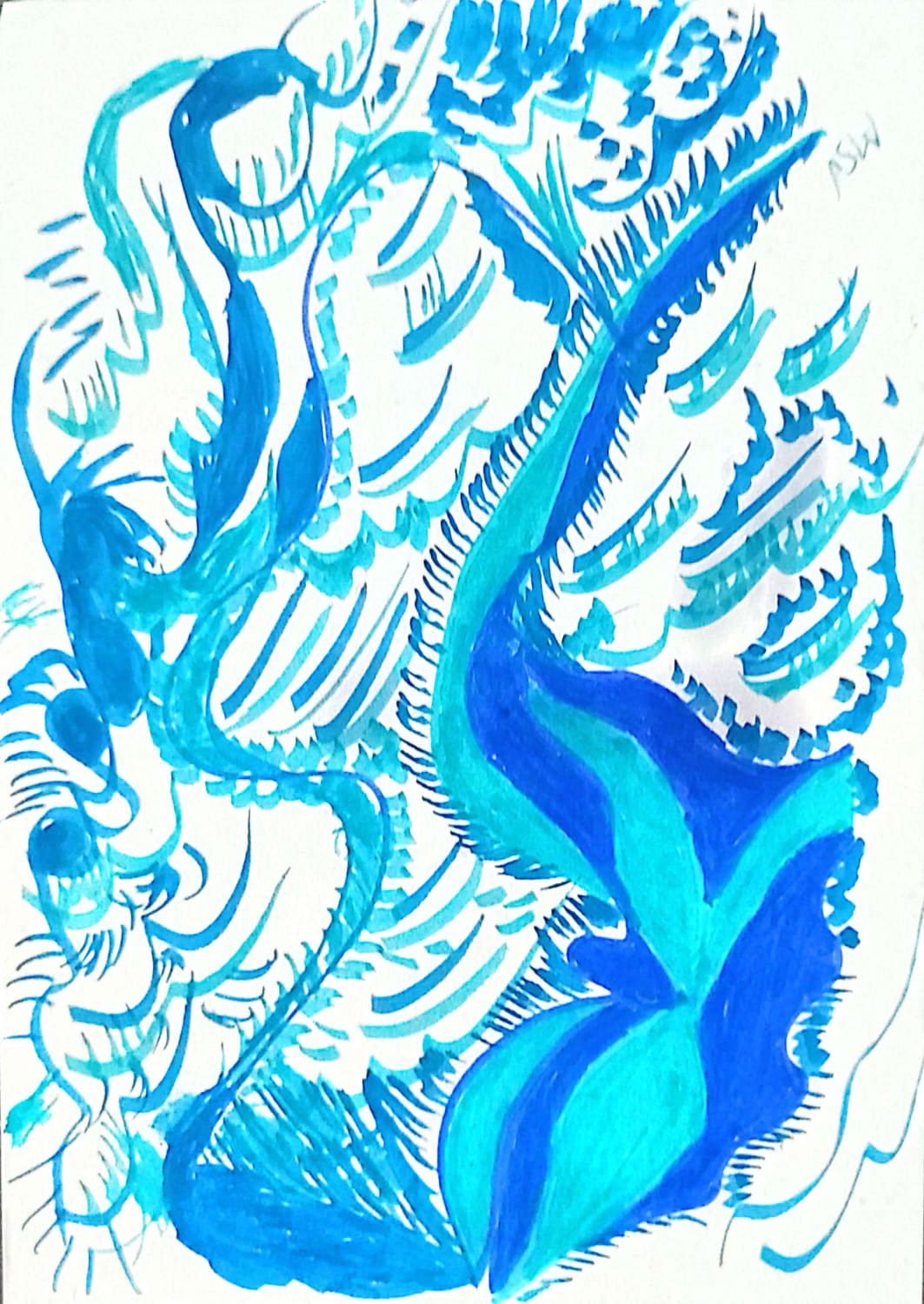

Comments 0