À l’écoute du monde, le cœur au rythme du Maroc

Par Houda Elfchtalli
—————–
Le 21 juin, depuis 1982, le monde entier célèbre la Fête de la Musique, une initiative née en France et devenue universelle. Plus de 120 pays et 700 villes y participent aujourd’hui, affirmant que la musique n’est pas un luxe ni un divertissement : elle est un droit vital, une expression de l’âme humaine, un pont entre les cultures.
La musique, écrivait Nietzsche, est « la véritable langue universelle ». Et c’est cette langue que nous parlons tous, sans apprentissage préalable, lorsque les tambours battent, que la voix s’élève ou que les cordes frémissent. Chaque peuple y inscrit son histoire. Chaque région y grave ses douleurs, ses espoirs, ses visions. Les musiques du monde sont des archives vivantes, souvent orales, toujours essentielles.
En ce jour de célébration, il serait injuste d’ignorer les musiques dites « authentiques », celles qui résistent à l’uniformisation, celles qui naissent d’un terroir et s’imprègnent d’un mode de vie. Le chant touareg, le flamenco andalou, les percussions sénégalaises, les maqâms orientaux, les polyphonies corses ou géorgiennes… Tous sont des héritages en mouvement, menacés parfois, résistants toujours.
Et le Maroc, dans cette mosaïque, est une étoile brillante, un carrefour de civilisations musicales. Ses traditions sonores sont aussi nombreuses que ses dialectes, ses climats ou ses paysages. Que l’on pense au malhoun, poésie chantée née au XIIIe siècle dans les médinas, au gharnati, noble descendant de l’Andalousie perdue, ou aux chants amazighs, transmis par les femmes de l’Atlas et du Rif comme une prière chantée à la vie.
Le malhoun, justement, a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en décembre 2023, consacrant ainsi des siècles de transmission poétique et musicale à travers les villes de Fès, Meknès, Salé et Marrakech. Une reconnaissance tardive mais essentielle pour cet art raffiné, à la fois populaire et savant, où le verbe se fait musique, et la musique, mémoire.
« La musique marocaine est un continent à elle seule », dit M. Abdelwahab Doukkali, maître intemporel de la chanson moderne. Il a raison : notre pays compte plus de 15 grandes familles musicales traditionnelles, sans compter les nombreuses variantes régionales. À Meknès et à Fès, le chant soufi élève les âmes ; à Essaouira, le gnawa convoque les esprits par le guembri et la transe ; à Casablanca, le chaâbi réunit les foules dans une ferveur populaire inégalée. Et que dire de l’aita, où les cheikhates racontent la société et l’histoire avec une puissance brute, pure et sincère.
En cette Journée de la Musique, saluons non seulement les artistes reconnus, mais aussi les musiciens anonymes, les derniers maîtres traditionnels, les passeurs d’oralité, les jeunes qui reprennent les instruments oubliés, ceux qui font vibrer le bendir ou renaître le oud dans des ateliers modestes mais habités.
Que cette journée soit une mémoire vivante, mais aussi un espoir. Car il ne s’agit pas seulement de célébrer, mais de préserver. L’UNESCO a déjà classé plusieurs formes musicales marocaines au patrimoine immatériel de l’humanité, comme l’art de l’aita, les rituels gnawa, et désormais le malhoun. Mais beaucoup d’autres restent en danger, faute de transmission ou de reconnaissance.
Souvenons-nous de cette parole de Rabindranath Tagore : « La musique remplit l’infini entre deux âmes. »
Le Maroc, dans l’infini sonore du monde, est un lien précieux entre l’Afrique, l’Europe et l’Orient. À nous de l’honorer, de l’écouter, de le transmettre.

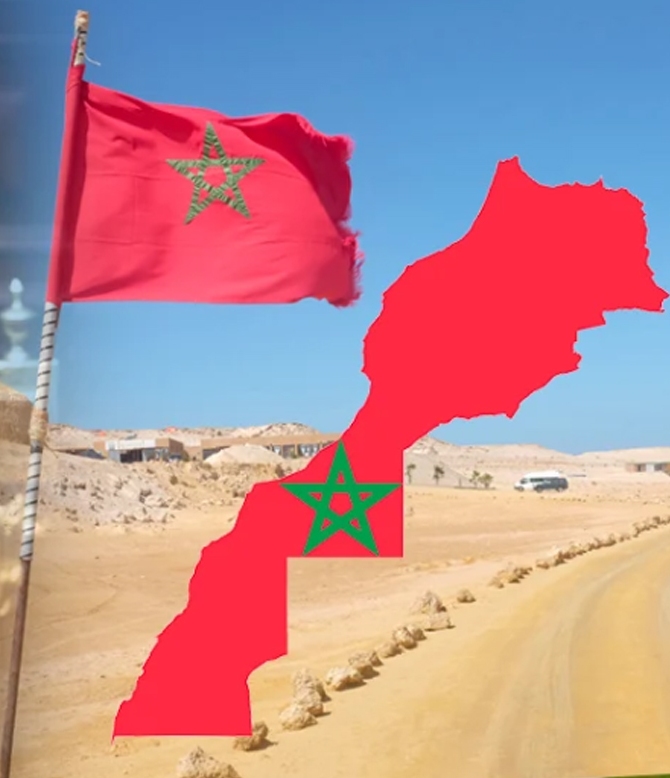
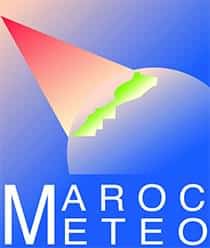


Comments 0