Le pouvoir politique du Sein…

Trop petite ou trop imposante, la poitrine féminine, (ou plus exactement ses seins), dispose, à travers l’Histoire, les histoires, les cultures et les civilisations, d’un Pouvoir au pluriel… Les pouvoirs.
En effet, les deux «bijoux» symbolisent la féminité, la maternité, la tendresse, la sexualité, la fertilité, la nourriture, le désir, le plaisir, la séduction, l’attirance….
Loin des convenances sociales, des conventions morales et des clichés dictés par le regard masculin, les seins, toujours présents dans les domaines artistiques et dans les écrits romantiques, ont également, depuis que le monde est monde, un pouvoir politique.
En fait, la formule n’est pas propre au mouvement féministe Femen (2008) ayant choisi sa manière radicale de s’exprimer avec les seins nus. Car, la colère manifestée par «le sein nu» a été exprimée auparavant au Canada par des étudiantes, en Argentine, par un groupe de femmes pour protester contre le machisme et au Pérou par des femmes afin de contrer une loi susceptible de limiter le droit à l’avortement.
Au dix-neuvième siècle, au salon de Paris, en 1831, une œuvre du peintre français, Eugène Delacroix, montrait et résumait les événements tragiques des trois jours, 27, 28 et 29 juillet 1830 par un groupe d’insurgés menés par une femme qui s’avance «le sein nu» face à la mitraille. Cette femme dénudée, portant le drapeau français et «guidant le peuple» symbolise, à elle seule, le pouvoir esthétique et politique du «sein nu».
Au seizième siècle, l’image de jeunes filles aux seins nus était utilisée, par le maître allemand de la Renaissance, le peintre Lucas Cranach, pour diffuser un message politique. Un message de résistance.
Plus loin encore dans l’Histoire, Cléopâtre, l’une des femmes les plus célèbres de l’Antiquité, et qui s’est suicidée par désespoir à la mort de son amant Marc-Antoine, était représentée «les seins nus» par tous les peintres. Cette inspiration a été confortée au seizième siècle par le dramaturge, poète et acteur anglais, William Shakespeare, qui écrira sur l’histoire : «Là, sur son sein paraît une trace de sang.»
Ainsi, de l’éternelle «bataille du sein», résumant l’ambiance d’une mère et de son nourrisson, au «règne des seins» illustrant le pouvoir du message politique accompagnant le sein, en passant par « La jeunesse d’un sein » du poète syrien d’origine turque, Nizar Kabbani, le langage des seins était toujours au cœur des débats et d’interprétations. Car, de la nature à la culture, l’homme est intimement lié au sein. Cela lui a été génétiquement transmis depuis le berceau et reste conditionné socialement jusqu’à la tombe, pour aimer les seins.
La trajectoire va des tout premiers moments complices quand sa mère le prenait sur ses genoux ou dans ses bras pour le nourrir, cherchant par réflexe purement naturel le sein pour téter, jusqu’à l’âge de découverte de cet attribut féminin le plus admiré.
Cette trajectoire va de l’attachement, l’amour et la confiance libérés pendant la tétée du sein maternel jusqu’à l’intimité imprégnée de la chaleur et de la tendresse du sein du partenaire.
Il s’agit donc d’une attirance innée et plus tard acquise. Le sein est également symbole de tolérance. Dans la mythologie comme dans notre culture, la mère pourrait dévoiler son sein pour implorer dans l’espoir de réconcilier ses enfants haineux. De même, dans un autre registre, une personne pourrait recourir à la puissance symbolique et la sacralité du sein maternel pour aiguiser la fibre humaine de son interlocuteur, en le suppliant «de prendre en compte le sein maternel» (ها عار البزولة).
Même le bébé qui n’a jamais tété apprendra plus tard de son inné les secrets de la sacralité et l’attirance de ce symbole de féminité. C’est pourquoi dans certains contextes, le «Saint» dans cette formule : «A quel Saint se vouer?», signifiant une situation d’extrême embarras, aurait cédé la place au «Sein», (nourricier et symbole sexuel et de séduction), pour donner une autre citation dans un autre registre : «A quel sein se vouer»…
Par B.A


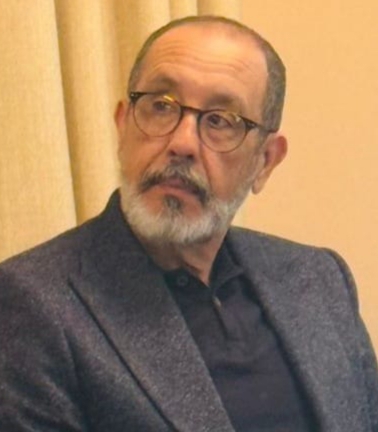
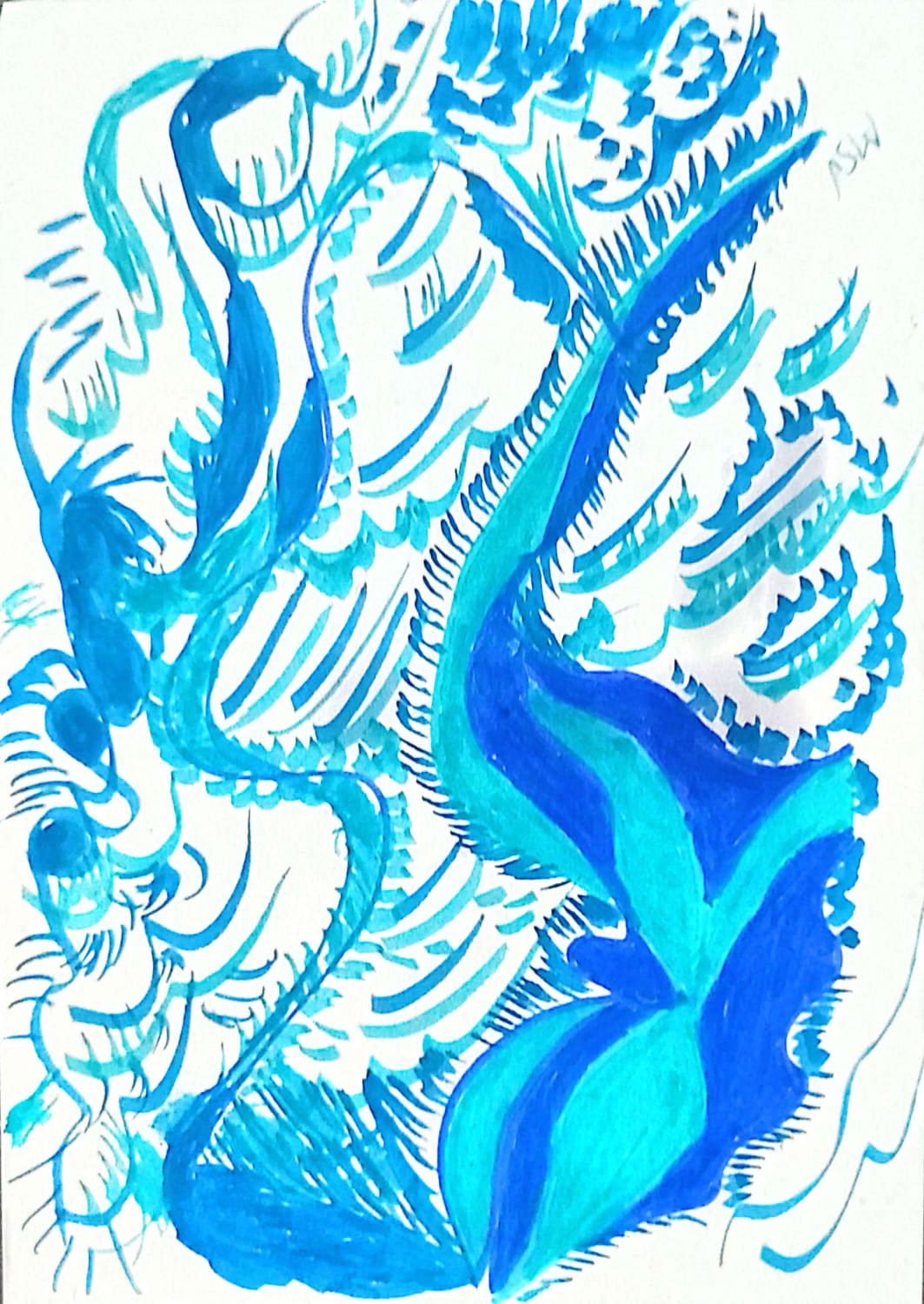

Comments 0