«Ma’ Zhar»; mémoire parfumée de Meknès

Par Houda Elfchtali
—————-
Au cœur du printemps, quand les jours s’étirent et que les vents du Moyen Atlas se font caresses, Meknès s’enveloppe d’un parfum singulier. Ce parfum, c’est celui de la fleur d’oranger — blanche, délicate, exquise — qui fait vibrer les ruelles de la médina, les vergers des douars, et même les cœurs les plus endormis. Chaque année, le rituel se répète : on cueille à l’aube ces fleurs précieuses, puis on les distille dans des alambics de cuivre hérités des aïeuls, pour en extraire l’eau de fleur d’oranger, appelée ici « ma zhar ».
Meknès n’est pas seulement une terre de murailles, de fontaines et de poètes. Elle est aussi une capitale sensorielle, un sanctuaire de savoir-faire où la distillation de la fleur d’oranger est à la fois un art et une mémoire. Depuis des siècles, les familles meknessies perpétuent ce geste ancestral, transmis de mère en fille, de père en fils, dans une alchimie de feu, de vapeur et d’amour.
L’histoire raconte que les premiers orangers furent introduits à Meknès sous Moulay Ismaïl, qui voulait orner sa capitale de jardins parfumés rivalisant avec ceux de Marrakech. Rapidement, la fleur devint plus qu’un ornement : elle s’inséra dans la pharmacopée traditionnelle, la pâtisserie fine, les rituels nuptiaux et même dans les cérémonies religieuses. « Ma grand-mère en mettait toujours quelques gouttes dans notre thé quand nous étions tristes ou malades, raconte Loubna, habitante du quartier Hamria. C’était son remède secret, son geste de tendresse. »
Aujourd’hui encore, malgré les mutations de la ville, la distillation de la fleur d’oranger résiste, discrète mais tenace. Dans les quartiers anciens comme dans les jardins du Saïs, des femmes alignent patiemment les fleurs sur des tissus blancs avant de les glisser dans les alambics. Il faut près de cinq kilos de fleurs pour produire un litre d’hydrolat. L’opération prend plusieurs heures, exigeant patience, précision, et un lien profond avec la plante.
L’eau de fleur d’oranger est bien plus qu’un parfum. Elle possède des vertus reconnues : apaisante pour le système nerveux, digestive, hydratante pour la peau, antiseptique naturel. Elle entre aussi dans la fabrication des cornes de gazelle, du chebakia, et même du couscous des grandes fêtes. Mais au-delà des usages, elle agit comme un baume pour l’âme. « Quand j’en verse dans mes préparations, j’ai l’impression d’y mettre un peu de Meknès », confie Fatima, pâtissière de Médina Jedida.
Avec l’engouement pour les produits naturels et le retour aux savoirs traditionnels, de jeunes artisans se réapproprient cette pratique. Certains l’associent à l’aromathérapie, d’autres la transforment en cosmétique artisanale ou en parfumerie de niche. Des coopératives rurales, notamment à Aïn Taoujdate et Oualili, essaient même de structurer la filière pour valoriser cette richesse locale.
Le souffle de la fleur d’oranger devient alors un fil invisible qui relie les générations, les collines et les cœurs. Il raconte une autre histoire de Meknès : plus douce, plus intime, mais non moins précieuse. Une ville qui sait encore prendre le temps d’un geste lent, d’un parfum évocateur, d’un souvenir distillé.


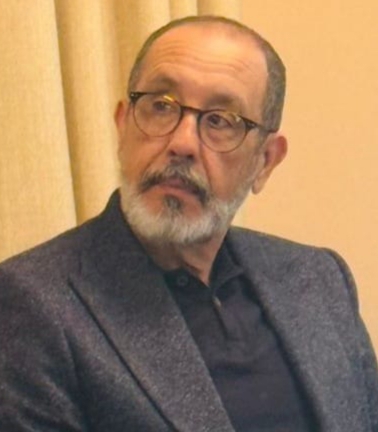
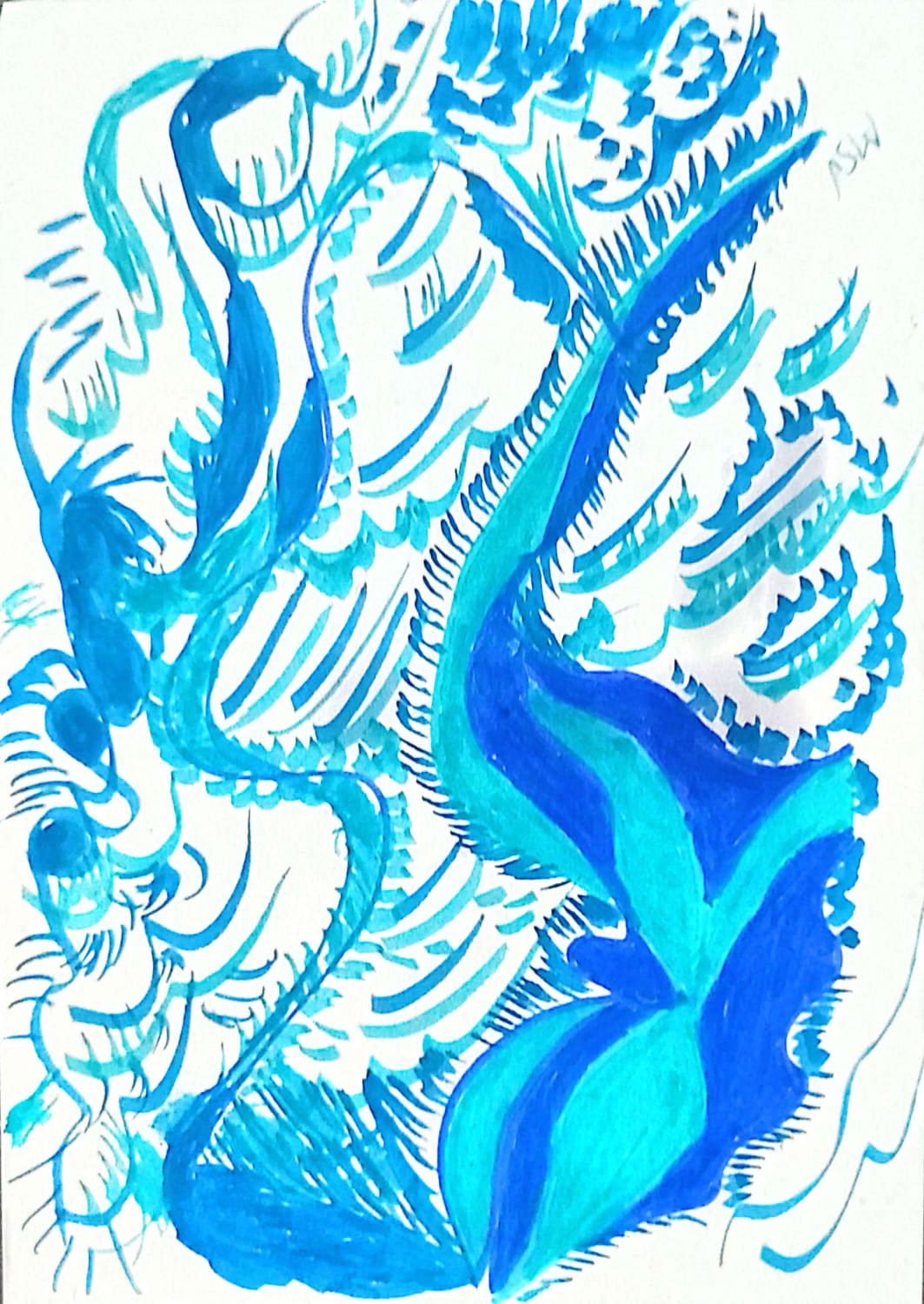

Reste bien à préciser qu’il s’agit de de fleurs d’oranges amères… Et non des orangers que nous mangeons de bon goût…