Médias et censure : Histoire d’un combat

———-Par Docteur Belkassem Amenzou
«La censure, quelle qu’elle soit, me parait une monstruosité, une chose pire que l’homicide ; l’attentat contre la pensée est un crime de lèse-âme. La mort de Socrate pèse encore sur le genre humain», Gustave Flaubert.
C’est un fait historique. La liberté d’expression et d’opinion a toujours été confrontée aux pratiques de censure[i]. La politique censure. La religion censure. La société censure (morale). Le terme, qui désigne la limitation arbitraire ou doctrinale de cette liberté, remonte à l’antiquité.
Elle consiste à examiner le contenu des livres, des journaux, des bulletins d’informations, des pièces de théâtres, des films, etc. avant d’en permettre la diffusion au public. Même avec le développement des nouvelles techniques de communication et de l’information, la pratique de censure s’est adaptée à la nouvelle ère, avec l’instauration de systèmes de filtrage et le développement des algorithmes pour supprimer des contenus sur la Toile ou réduire l’accès à d’autres…
La pratique consiste à restreindre massivement l’accès à certaines informations sans les supprimer tout à fait, et à augmenter la diffusion des contenus jugés «dignes de confiance», c’est-à-dire produits et contrôlés par des experts d’autorité.
Constat historique
L’Histoire nous apprend que cette pratique était fortement instituée dans la république romaine et cadrée par la législation en vue de lui assurer toutes les garanties d’efficacité. C’est dans ce sillage que le législateur romain avait ramené le mandat des censeurs de cinq ans à dix-huit mois pour barrer la route à toute forme d’abus. De même, les décisions du censeur, qui avait un pouvoir absolu, ne pourraient faire l’objet d’opposition, de recours ou d’examen par la justice. Seul un autre censeur, qui lui succédera, pourrait revoir ces décisions et les annuler.
En effet, depuis la pratique de l’affichage jusqu’au virage numérique des temps modernes, en passant par l’ère de l’apparition dans le monde des premiers hebdomadaires et quotidiens au 17ème siècle, leur apogée à la fin du 19ème siècle et l’invention des médias audiovisuels au 20ème siècle, la censure a toujours été sérieusement prise en compte dans les politiques des pouvoirs.
Dans la république romaine, les affiches n’étaient envoyées aux différents coins de la province qu’après le contrôle de leurs contenus par des préfets. En France, le roi François 1er avait même proclamé, en novembre 1539, un édit lui réservant l’usage exclusif de l’affichage. En 1629, le royaume de France étatisa et laïcisa la censure en nommant les premiers censeurs royaux.
Dans l’empire de Bonaparte Napoléon, le service de censure était rattaché directement à l’empereur. «Si je lâche la bride à la presse, je ne reste pas trois mois au pouvoir», avait-il souligné. Et lorsque Bonaparte avait annoncé des ouvertures et des libérations, la réalité était, en fait, de censurer par le moyen des lois[ii]. Depuis lors, les législations, qui se mettaient en place, n’avaient jamais omis de garder l’œil vigilant de la loi sur le secteur.
Certes, les choses différaient d’un régime à un autre, mais les uns et les autres s’accordaient sur le fond de la matrice que chacun présentait à sa façon. Durant les deux guerres mondiales, les médias étaient fortement muselés par les pouvoirs qui défendaient les mesures d’oppression par le fait de protéger les nations contre l’espionnage des ennemis, alors que la réalité était de mater les journalistes qui critiquaient la manière dont se déroulaient les choses aux fronts.
C’est dire qu’en temps de paix comme en période de guerre, la pratique de censure n’a jamais disparu des écrans des radars du pouvoir. En fait, tout ce qui se rattachait à l’esprit et à la parole était soumis à la surveillance d’un pouvoir qui redoutait l’histoire.
Actions de ciblage
L’histoire du journalisme a toujours été fortement liée à la liberté d’expression et à son combat contre la censure. Et celle-ci dure, perdure, change de couleur pour se fondre dans le décor, s’adapte et cible ses actions. Quand elle cible le journalisme, activité qui consiste à collecter des informations, à les vérifier et à les mettre à la disposition du public et dans l’espace public[iii], la censure a toujours visé l’un de ces trois piliers constituant la définition de cet exercice. Ainsi, le détenteur du pouvoir pourrait attaquer à la racine, c’est-à-dire la collecte de l’information, en procédant à la fermeture de l’entreprise.
Dans ce registre, différentes explications seraient avancées pour «légitimer» la décision de fermeture. Cela pourrait être présenté sous forme d’une accusation de diffusion d’informations de nature à perturber l’ordre public jusqu’à l’atteinte à la stabilité de l’Etat, à l’intégrité territoriale, en passant par l’ébranlement de la foi. Et les médias publics et autres gravitant dans les sphères du même pouvoir servent de «caisses de résonnances» pour désinformer l’opinion publique et la manipuler. Cependant, avec l’évolution de la société et le développement des techniques de l’information, cette mesure devenait coûteuse politiquement pour le pouvoir, sans pour autant l’abolir définitivement, liant son application à un verdict de la justice. Quoi qu’il en soit, le but étant toujours le même, celui de «faire taire».
Le deuxième axe d’intervention de la censure ciblait le volet de «la vérification de l’information avant sa mise à la disposition du public ». A ce niveau, les pouvoirs mettaient en place des «codes sur le droit d’accès à l’information». Cela est servi à l’opinion publique comme une volonté politique garantissant la liberté d’expression et d’opinion, mais en réalité il s’agissait d’un verrouillage réglementé et permettant une surveillance[iv] de la circulation de l’information.
Ce qui influencera, à coup sûr, l’investigation, l’enquête et tout simplement la vérification de la véracité de l’information, surtout politique, économique ou financière. Ne dit-on pas que «celui qui détient l’information, détient le pouvoir». Ce vieil adage reste souvent vérifié non pas uniquement en politique, en temps de paix comme en temps de guerre, mais également dans le domaine de l’économie où l’information permettrait de connaitre les besoins des consommateurs, les actions des concurrents et les évolutions du secteur en général. C’est ainsi que des publicités aiguisent les appétits, font croitre les désirs, sur des tons infantilisants, s’adressant à l’instinct et à l’émotionnel.
S’agissant du troisième axe de la définition du journalisme, consistant à «la mise de l’information à la disposition du public», le pouvoir pourrait intervenir aux niveaux des circuits de distribution et de diffusion. Ainsi, des informations, bien vérifiées, bien agencées, bien rédigées, mais non mises à la disposition du public, n’auraient aucun impact sur la population ciblée.
Ces informations ne seront, en fin de compte, lues et consultées que par les équipes des médias qui les avaient dirigées, en plus des dégâts occasionnées par leur confection. La balle est ainsi neutralisée à la bouche du canon.
Il en ressort qu’à cette échelle de la définition même du journalisme, principale activité des médias, reste vigoureusement sous la loupe des pouvoirs qui pourraient étendre cette pratique de censure à d’autres formes d’atteintes à la liberté d’expression avant et/ou après la diffusion (censure a priori et a posteriori).
Ce climat développera automatiquement l’autocensure chez les professionnels des médias pour ne pas tomber sous le coup de la justice avec des poursuites judiciaires pour «publication de fausses informations de nature à …..». L’autocensure devance ce qui est perçu comme une menace (réelle ou supposée) de censure par une autorité (politique, financière, religieuse, etc) ou plus largement pour être en parfaite harmonie avec «le politiquement correct»[v]».
Conclusion
Toutes les relations sociales sont marquées par une forme d’autocensure. Il s’agit d’une formule qui permet aux individus et aux sociétés d’éviter l’explosion et/ou l’implosion par la non-énonciation d’une vérité qui ne peut être entendue par l’autre ou par les autres. Pascal Durand («Lieu commun et communication », pp. 83-108) présente «le fait de censure non comme silence, césure ou blanc dans le langage, mais comme cet acte langagier qui, dans le discours médiatique, consiste à remplacer ce qui ne peut se dire ou vouloir se dire par toute une rhétorique de lieux communs, de stéréotypes et de clichés nourris par la doxa ambiante et l’alimentant en retour».
C’est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle «la censure invisible». «Cette censure est une censure non explicite, mais qui est en nous car la télévision l’a instaurée en nous, une censure composée de ce qui est tolérable, ou non, par les autres. Nous ne sommes pas au courant de cette censure, mais notre inconscient l’est».
C’est le résultat du processus de socialisation, du poids des traditions, du conditionnement social[vi] et de la sujétion des médias au «politiquement correct». De ce fait, il s’agit d’un type de censure subtil : il permet d’éviter au pouvoir la forme contraignante d’une censure effective, qui serait mal perçue par l’opinion. Car la censure, quelle que soit sa forme, stimule le courage là où la corruption anéantie les forces combatives. Lorsque les journalistes étaient censurés par le politique, la lutte était plus facile. Elle stimulait les valeurs héroïques, la solidarité, le goût pour la liberté, pour l’éthique et la déontologie. C’est pour cela que les détenteurs du pouvoir misent, depuis la fin du vingtième siècle, sur l’ingénierie sociale[vii] comme armes silencieuses du conditionnement social.
Aujourd’hui, pour se libérer du système il faudrait reconnaître ses défaillances et renoncer à ses privilèges. Deux choses terriblement difficiles pour tout être humain.
[i] Le mot latin censura, d’où vient le mot censure, désignait la fonction de censeur à Rome apparu en -440. Les censeurs, au nombre de deux, avaient entre autres responsabilités celle de faire le recensement, d’évaluer les biens, de veiller sur les mœurs et de contrôler la moralité des citoyens. Le verbe censeo signifie d’abord estimer, évaluer et, en second lieu, juger… censurer.
[ii] Selon l’article 11 du décret règlementant l’imprimerie et la librairie, chaque imprimeur sera tenu d’avoir un livre, noté et parafé par le préfet du département, où il inscrira, par ordres de dates, le titre de chaque ouvrage qu’il voudra imprimer, et le nom de l’auteur. Ce livre sera présenté à toute réquisition, et visé s’il jugé convenable, par tout officier de police.
[iii] Selon le concept développé par le philosophe allemand Jürgen Habermas, le régime démocratique repose sur un espace public dans lequel les questions d’intérêt général sont posées et débattues publiquement, puis tranchées à partir de l’échange et de la confrontation d’arguments rationnels. Les médias jouant un rôle primordial dans ce processus.
[iv] Dans le cas où des médias formulent des demandes pour obtenir certaines informations dont le traitement nuirait au pouvoir, ce dernier aura ainsi la possibilité d’entrer sur la ligne pour agir, verrouiller ou manipuler.
[v] L’expression est un calque de l’anglais «politically correct». Le corollaire français du politiquement correct est une forme de la langue de bois.
[vi] Le conditionnement social serait l’action, étalée dans le temps, de la société sur les comportements cognitifs de chaque être humain qui la compose.
[vii] Un ensemble de pratiques visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux…
Bibliographie
Christian Salomon, Verbicide : Du bon usage des cerveaux humains disponibles ; Actes sud 2007 (Collection Babel)
Hélène Bellour, Nelly Kuntzmann, Marie Kuhlmann, Censure et bibliothèques au XXème siècle ; Cercle de la Librairie, 1980
Jean-Michel Ducomte, La censure ; Milan 2007
Patrick Champagne, La double dépendance, Edition, Raisons d’Agir, 2016.
Pascal Durand (éd.), Médias et censure. Figures de l’orthodoxie, Éditions de l’Université de Liège, coll. «Sociopolis», 2004
Tristan Mattelart, Tiers Monde et audiovisuel sans frontières, De Boeck Supérieur, 2002
Webographie
Eveline Pinto, « Jacques Bouveresse, Bourdieu, savant & politique », Questions de communication, 7 | 2005
http://journal.openedition.org/questiondecommunication/5477
http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5578


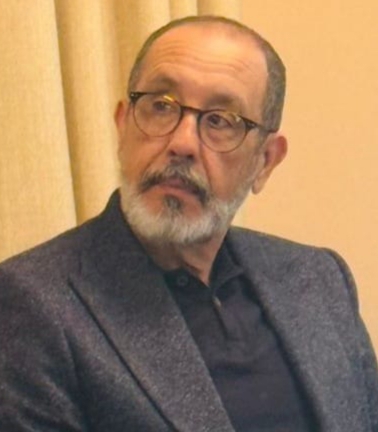
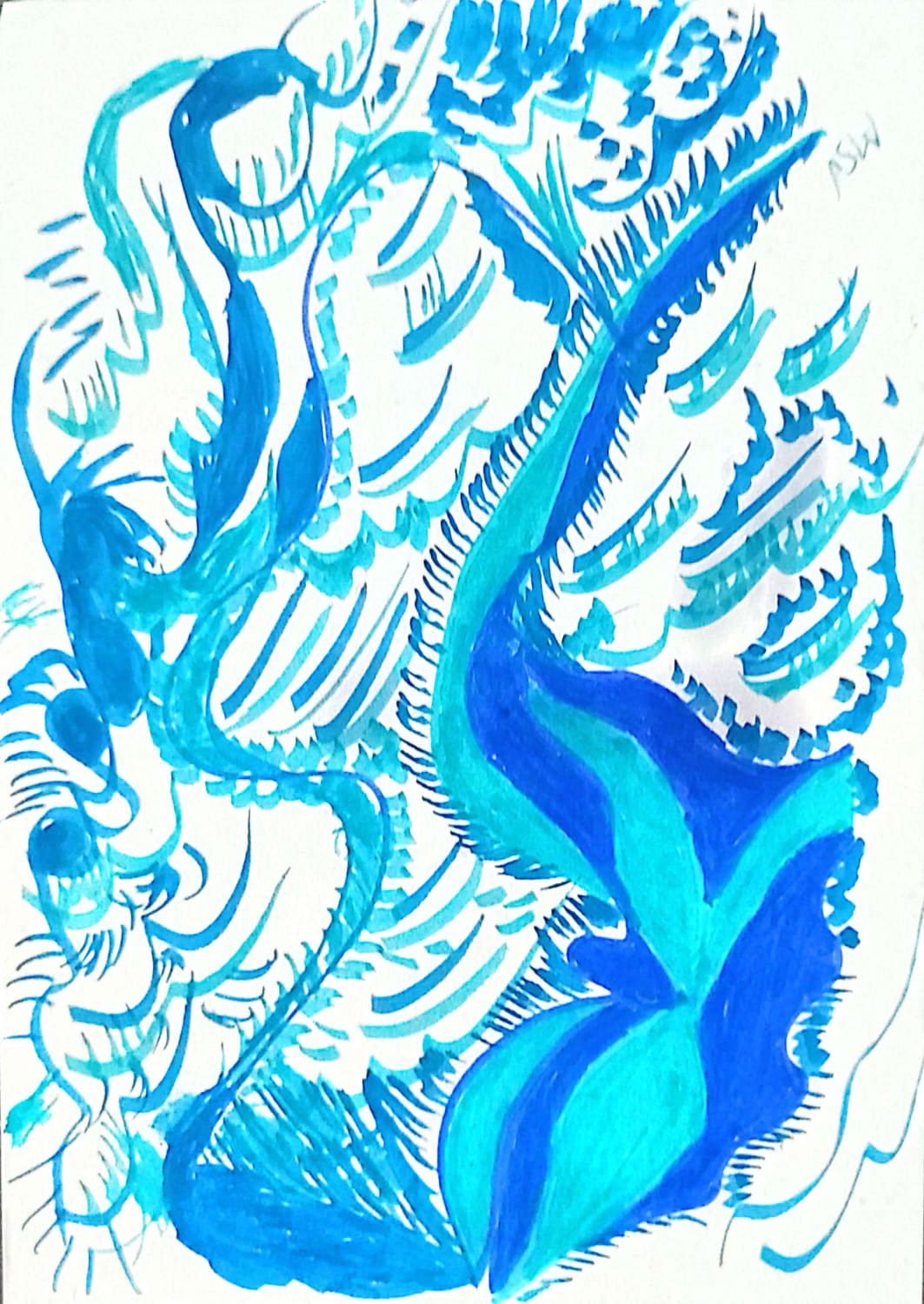

Comments 0